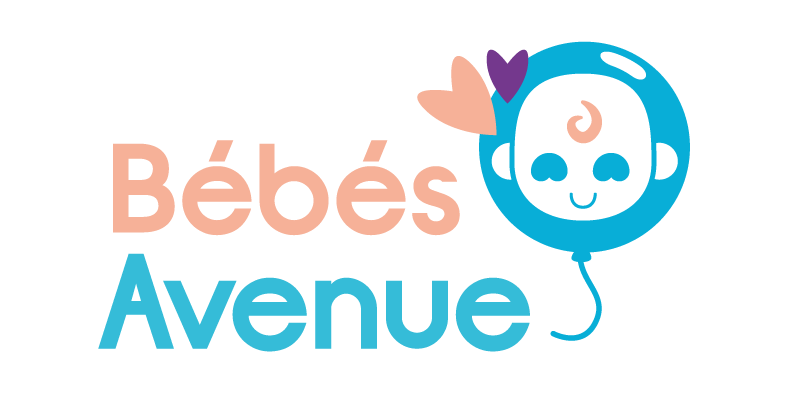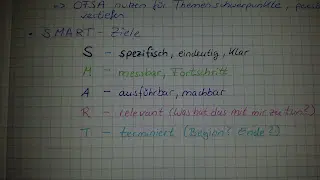Oui-Oui ne coche aucune case, et c’est peut-être ce qui explique sa longévité. Sa présence dans les chambres d’enfants, sur les étagères, dans les souvenirs, n’a rien d’anodin : au fil des générations, il déjoue les attentes, désarme les certitudes, et échappe à toute tentative de classement définitif. Ce petit personnage à la voiture jaune n’est pas seulement une icône : il est un point d’interrogation ambulant, et c’est bien ce qui met les adultes au défi.
Oui-Oui : un personnage au genre ambigu qui interroge petits et grands
Oui-Oui occupe depuis des années une place singulière dans l’univers des enfants. Sa présence ambiguë intrigue et suscite des discussions animées. D’un ouvrage d’Enid Blyton à l’autre, d’une adaptation télévisée à la suivante, le visage rond, la voix claire et les couleurs vives du personnage brouillent les repères habituels. Les parents s’interrogent : garçon ou fille ? La question s’invite à table, dans les échanges avec les enfants, et divise même les plus attentifs aux enjeux liés au genre.
Dans les éditions originales, Oui-Oui est désigné au masculin, mais la version française et l’aspect du personnage sèment le doute. Un prénom indéterminé, une allure en rupture avec les codes traditionnels, et soudain, Oui-Oui devient ce terrain de projection où chacun réinvente les frontières de l’enfance. Selon une enquête IFOP réalisée en 2016, près d’un tiers des parents hésitent à trancher : certains préfèrent laisser l’enfant choisir, d’autres contournent la question.
Ce flou n’a rien d’anecdotique. Oui-Oui met à l’épreuve les stéréotypes de genre et questionne la souplesse des images que l’on donne aux plus jeunes. L’imaginaire collectif reste largement imprégné de la figure du « garçon meneur » : dès l’âge de 4 ans, une étude du CNRS montre que les enfants associent le pouvoir à la masculinité. Pourtant, la popularité de Oui-Oui démontre qu’il existe des espaces où les frontières s’estompent. Les parents, parfois déroutés, oscillent entre leurs propres repères, les normes sociales et ce désir d’ouvrir d’autres perspectives. C’est là que se révèle la force, et la souplesse, des modèles transmis, mais aussi la capacité à en inventer de nouveaux.
Pourquoi la question du genre de Oui-Oui fascine-t-elle autant les parents ?
L’intérêt des parents pour le genre de Oui-Oui ne relève pas du hasard. Cette petite figurine ni vraiment garçon, ni tout à fait fille, réactive les discussions sur les stéréotypes de genre qui traversent la société. Pour beaucoup, l’ambiguïté de Oui-Oui agit comme un révélateur. Que transmet-on aux enfants à travers les jouets, les histoires, les héros de papier ou d’écran ?
Ce questionnement prend racine dans un contexte où les attentes liées à la masculinité et à la féminité s’installent très tôt. Des recherches menées par le CNRS, en partenariat avec les universités d’Oslo, Lausanne et Neuchâtel, ont mis en lumière que les enfants associent le pouvoir à la masculinité dès 4 ans, en France, mais aussi en Norvège ou au Liban. Le personnage de Oui-Oui, figure familière de l’enfance, devient alors un terrain de débat à la maison : faut-il choisir pour l’enfant ? Laisser le doute ? Ou simplement accueillir cette indétermination ?
Ce jeu de questions, parfois subtil, met en lumière le rôle de l’éducation dans la façon dont les rôles sociaux se transmettent. Que ce soit dans la sphère privée ou à l’école, les adultes véhiculent, souvent sans y penser, des modèles sexués à travers le langage, les vêtements, le choix des livres. Oui-Oui, avec son genre indéfini, pousse à interroger ces habitudes. Chaque parent y projette ses convictions, ses doutes, son envie d’égalité entre filles et garçons.
Face à cette diversité de réactions, voici les principaux points de vue qui émergent dans les familles :
- Certains valorisent la dimension neutre du personnage et y voient une chance de sortir des cases habituelles.
- D’autres regrettent l’absence de repères nets, craignant que cela ne trouble la compréhension des enfants.
- Une part plus restreinte y trouve un prétexte pour discuter de la pluralité des identités, dès le plus jeune âge.
Le débat ne se limite pas à l’anecdote : il touche à la manière dont les adultes accompagnent l’enfant dans sa découverte du monde, et à la capacité collective à réinventer la façon dont on parle du masculin et du féminin.
Perceptions parentales : entre projection, stéréotypes et influence des médias
Oui-Oui, avec son apparence indéfinie, agit comme un miroir dans lequel se reflètent les attentes et les imaginaires parentaux. La question du genre devient vite une affaire de projection : certains voient en Oui-Oui un garçon, d’autres s’autorisent à garder le flou, convaincus qu’un héros sans étiquette peut encourager une éducation qui laisse plus de place à l’égalité.
Le langage du quotidien, parfois chargé d’expressions comme « sois un vrai garçon » ou « fais pas ta chochotte », trahit la persistance de schémas stéréotypés. Pihla Hintikka et Elisa Rigoulet, autrices de Fille-garçon, même éducation, rappellent que la socialisation sexuée commence très tôt, avant même l’âge de l’école. Les livres pour enfants, omniprésents dans les foyers, fourmillent de clichés : la mère occupée aux tâches domestiques, le père actif à l’extérieur. Ces récits ancrent une vision binaire du monde dès les premières lectures.
Les maisons d’édition, soucieuses de toucher le public le plus large, hésitent souvent à publier des histoires mettant en scène des garçons qui sortent du cadre habituel. Cette prudence éditoriale contribue à modeler l’imaginaire collectif autour du genre. Johanna Guetta, psychothérapeute, incite à aborder l’égalité avec les enfants, sans éluder la discussion sur les stéréotypes véhiculés par les jeux, les livres, les images.
Pour accompagner l’enfant dans cette réflexion, plusieurs pistes méritent d’être explorées :
- Analyser avec l’enfant les rôles attribués aux personnages de ses histoires préférées.
- Questionner la variété des modèles offerts par les médias et les supports culturels.
La vigilance des parents, associée à une lecture attentive des livres et émissions, permet de déconstruire ces réflexes et d’ouvrir un espace où le masculin et le féminin se dessinent de façon moins rigide.
Quel impact sur l’identification des enfants et leur construction de genre ?
Dès la maternelle, les enfants associent spontanément la domination à la figure masculine. L’étude menée par le CNRS et plusieurs universités européennes le confirme : garçons et filles, en France, au Liban ou en Norvège, identifient le pouvoir au masculin, même si le héros présenté semble neutre. Oui-Oui, avec son absence de signes sexués marqués, perturbe cet automatisme, mais les vieux schémas de classement selon le genre résistent.
Dans le quotidien des crèches, la répartition des activités reste révélatrice. On oriente plus souvent les filles vers la dinette ou les poupées, pendant que les garçons s’approprient les jeux moteurs. Certaines structures, inspirées par l’exemple nordique de la crèche neutre, s’efforcent de contrer cette tendance, mais la question du genre, discrète ou frontale, s’infiltre dans chaque interaction. Même lors des animations avec des marionnettes, on observe que les garçons se reconnaissent surtout dans le personnage dominant, à condition qu’il leur ressemble, tandis que les filles se montrent moins catégoriques, plus ouvertes à l’indétermination.
Oui-Oui, par sa singularité, devient pour l’enfant un véritable laboratoire d’expérimentation de son identité. Face à ce héros indéfini, chaque enfant cherche sa place, hésite, interroge les limites. Les garçons ont tendance à attribuer le pouvoir à un personnage masculin, les filles, elles, n’associent pas nécessairement le genre à la position dominante. Cette différence met en lumière la force des modèles sociaux transmis si tôt, et souligne le besoin de former davantage les professionnels de la petite enfance à ces enjeux, comme le rappellent plusieurs responsables de crèche engagées dans ce travail de réflexion.
Oui-Oui ne donne pas de réponse définitive. Il invite à regarder autrement, à laisser la place au doute, à l’inattendu. Les enfants s’identifient, questionnent, imaginent. Et si la vraie force de ce petit personnage était, justement, de ne rien interdire ?